
Le blog du Muséum

L'Oceanosuchus : trésor des réserves paléontologiques
Le 9 août 2023 par Louise Bourget
Le Muséum du Havre regorge de curiosités et de spécimens rares ! Parmi elles, la conservation d’un squelette partiel d’Océanosuchus. Ce crocodile marin, de son nom complet – Océanosuchus Boecensis -, est un des éléments phares des collections paléontologiques du musée. On vous explique pourquoi !
Un crocodile marin en Normandie ?
Pas de panique ! Si ce prédateur marin a bien été découvert sur le sol normand, c'est sous forme d'os fossilisés !
C'est au début des années 2000. Des os sont retrouvés par Patrick Rogron, sur le chantier de travaux de voiries, dans la commune de Mortagne-au-Perche (Orne, Normandie). Le chantier est interrompu et les os font aussitôt l'objet d'une expertise plus approfondie. Bien vite, les experts se rendent compte qu'ils font face à des éléments fossilisés peu ordinaires... Pour cause, ceux-ci appartiendraient à un spécimen crocodilien disparu.
L'animal en question aurait vécu à l'étage du Cénomanien, c'est-à-dire il y a environ 98 millions d'années. À cette époque, la Normandie, tout comme presque l'entièreté de la France métropolitaine, était recouvert d'une mer chaude. Un environnement propice au mode de vie des crocodiliens.
Dessin de Michael B.H., source Wikipedia
Le docteur en paléontologie Stéphane Hua, descripteur du spécimen, a pensé d'abord identifier une nouvelle espèce qui appartient à la famille des Pholidosauridés*. Or, en menant à bien leurs expertises, ils découvrent des éléments surprenants…
Crâne fossilisé de l’Oceanosuchus boecensis
Le spécimen de Normandie possède des caractéristiques uniques telles que son crâne mésorostiné (c'est-à-dire, de taille moyenne et dont la partie avant est plus courte que dans d'autres genres) et la présence de « tubérosités appariées » ** à la base de ses vertèbres cervicales. Ces deux éléments permettent entre autres aux chercheurs de distinguer ce crocodile des autres Pholidosauridés déjà répertoriés.
À partir des ossements, les scientifiques ont réussi à établir l’environnement de vie du crocodile marin. Il semblerait que l’Oceanosuchus vivait dans un environnement de plateforme carbonatée typique des eaux tropicales (chaleur comprise entre 20 et 25 degrés). Cela correspond à l’environnement normal du Bassin parisien*** pendant l'ère MésozoÏque (entre 250 et 66 millions d'années).
Si le spécimen a été trouvé loin du rivage (correspondant à la période), il ne fait aucun doute qu'il était dépendant d'un environnement terrestre pour la ponte.
Au niveau de son alimentation, l’Oceanosuchus boecensis est suspecté avoir eu un régime dit ichtyophage. C’est-à-dire une nourriture essentiellement composée de poissons.
Les particularités de ce crocodile marin sont si marquantes qu’il sera classé comme nouvelle espèce à part entière : l’Oceanosuchus boecensis. On appelle ce type de spécimen "holotype".
* La famille des pholidosauridés représente une branche de méso-crocodyliens apparue à la fin du Jurassique (il y a 150 millions d'années).
** Une tubérosité osseuse est un épaississement de l'os à l'endroit où les forces de traction sont les plus importantes. Le terme appariée renvoie à la notion de paires.
*** Région géologique située au nord de la France et dont la structure est une vaste cuvette sédimentaire.
Qu'est-ce qu'un holotype ?
Un holotype est un spécimen à partir duquel une espèce végétale ou animale a été décrite pour la première fois et qui sert de référence. Il est le type original et a été désigné par l'auteur explicitement dans la publication scientifique originale.
Le spécimen conservé au Muséum du Havre est l’holotype de l’Oceanosuchus boecensis. On ne peut affirmer combien de fois celui-ci a servi de référence pour établir l’existence d’un nouvel Oceanosuchus boecensis car les données sont inexistantes. Cependant, selon Javier Pàrraga, chargé des collections de paléontologie, le spécimen a déjà été comparé à plusieurs reprises et apparaît dans de nombreuses analyses phylogénétiques* qui discutent de l'évolution des différents groupes des crocodiles.
Plaques cutanées de l’Oceanosuchus boecensis
Rangement contenant le crâne fossilisé du spécimen d'Oceanosuchus boecensis
Les holotypes sont hautement prioritaires dans le plan de sécurité du MMuséum et sont les premiers à être secourus en cas de catastrophe. Ils sont marquées de ce logo bleu.
La découverte de ce spécimen est intéressante car les Pholidosauridés étaient représentés pendant le début du Crétacé supérieur surtout en Amérique du nord et Afrique mais très peu en Europe. Ce nouveau taxon permet d'en savoir plus sur les formes crocodiliennes présentes en Europe et sur les étapes tardives de l'évolution des Pholidosauridés.
Le Muséum, avec l'aide des associations de paléontologie de la région, continue d'essayer de percer les secrets de ces fascinants prédateurs. Il faut être patient car, sur nos côtes, les fossiles sont emprisonnés dans la roche et celle-ci n'érode que petit à petit.
Photos : Cléa Hameury
Commentaires
Ajouter un commentaire
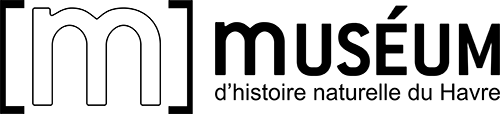
Vous accueille du mardi au dimanche
10h - 12h / 14h - 18h
Fermé le jeudi matin et le lundi
Place du vieux Marché, 76600 Le Havre
Téléphone : 02 35 41 37 28
Courriel : museum@lehavre.fr

Gardez
le contact
inscrivez-vous à a newsletter



